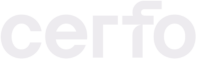En 2017, l’agrile du frêne a été détecté dans la ville de Québec. Cet insecte peut ravager des populations entières de frênes en quelques années. Comme le frêne est particulièrement présent en bordure de cours d‘eau et a été une espèce privilégiée pendant longtemps dans le cadre des plantations agroforestières, des mesures doivent être prises pour limiter et retarder la progression de l’agrile du frêne et réduire ses impacts dans le milieu agricole. Les objectifs spécifiques du projet sont alors les suivants : 1) Localiser les secteurs à risque présentant une forte concentration de frênes, en particulier en bordure de cours d’eau comme la rivière du Cap Rouge et dans les aménagements de haies brise-vent; 2) Sensibiliser les propriétaires agricoles, chez lesquels une grande concentration de frênes est retrouvée, aux dommages occasionnés par la présence de l’agrile du frêne; 3) Sensibiliser les producteurs agricoles aux bienfaits du repérage de l’agrile du frêne; 4) Assurer la formation des propriétaires sur l’identification et le suivi de l’insecte; 5) Proposer des stratégies aux producteurs pour limiter les impacts négatifs de l’agrile sur leurs propriétés.
Le projet comprend un volet de sensibilisation et un volet de dépistage. Tout d’abord, les producteurs agricoles pour lesquels nous retrouvons une proportion minimale de 20% de frênes ou 50 frênes dans leurs aménagements sont en train d’être identifiés. La photo-interprétation de bordure de cours d’eau débute tout juste. Elle permettra de préciser les propriétaires des terres où le frêne est présent en concentration. Du matériel de sensibilisation a aussi été développé tel un dépliant de sensibilisation, une présentation ou encore une pancarte à installer chez les producteurs impliqués dans le projet (en cours). L’étape de mobilisation en est à ses débuts : les producteurs ciblés seront contactés individuellement pour les sensibiliser au problème de l’agrile et vérifier leur intérêt à participer à une rencontre de groupe ou visite terrain organisée sur le sujet. La présentation du projet lors d’activités déjà planifiées par un organisme tiers est aussi en cours, afin d’augmenter la visibilité du projet et rejoindre davantage de producteurs concernés. Le volet Dépistage, quant à lui, débutera à l’année 2 (été 2019).